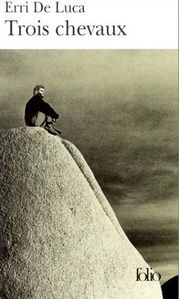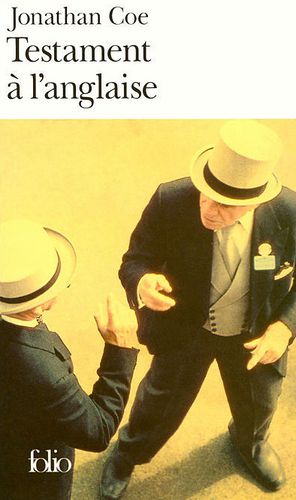Roman de Philip Roth en trois temps, comme une dernière valse, comme un pièce de théâtre en trois actes :
1er temps - Dispersés dans l'air léger
2ème temps - La transformation
3ème temps - Le dernier acte
Trois moments de la vie d'Axler, un célèbre acteur de théâtre qui éprouve à soixante cinq ans une impossibilité à jouer en scène. Il a perdu son intuition. Pour lui, c'est le drame qui surgit du quotidien.
1er temps - Dispersés dans l'air léger
"Il avait perdu sa magie" est la première phrase du roman. "Il s'était soudain retrouvé incapable de jouer". D'emblée le lecteur se trouve face à ce constat.
"Peu d'acteurs de théâtre savaient parler et écouter comme lui et, pourtant, il ne savait plus faire ni l'un ni l'autre. Les sons qui, auparavant, entraient dans son oreille, lui donnaient l'impression d'en sortir, et toute parole qu'il prononçait semblait jouée et non parlée. La source première de son jeu était dans ce qu'il entendait, sa réaction à ce qu'il entendait en était le coeur, et s'il ne pouvait ni écouter, ni entendre, il n'avait plus rien sur quoi s'appuyer." (p.14)
Cette situation soudaine est tragique et le pire est qu'Axler s'interroge sur la réalité de sa souffrance : est-elle authentique, ne l'est-elle pas ? Suis-je dans la réalité, suis-je dans le jeu ? Situation binaire très courante chez les personnages de Roth toujours en proie au doute.
" Etre seul le terrifiait, il ne parvenait à dormir que deux ou trois heures par nuit, il mangeait à peine, chaque jour il envisageait de se tuer avec le fusil qu'il avait dans le grenier - un fusil à pompe Remington 870 qu'il gardait dans sa ferme isolée pour se défendre le cas échéant - et tout cela demeurait malgré tout du théâtre, du mauvais théâtre. Quand on joue le rôle de quelqu'un qui craque, il y a une structure, un ordre. Quand vous vous observez vous-même en train de craquer, que vous jouez le rôle de votre propre fin, c'est tout autre chose, quelque chose qui est submergé par la peur et l'épouvante." (p.15)
Les ingrédients sont réunis : un fait soudain qui fait basculer une vie, l'impossibilité pour l'acteur de jouer un rôle sur scène et les conséquences de cette situation sur la vie de cet acteur. Et ensuite des doutes et une hésitation du personnage principal entre continuer à vivre ou se suicider.
Mais la vie continue et plusieurs événements vont se produire. Lesquels ?
Il y a d'abord la relation avec sa femme Victoria. Elle-même ancienne actrice, connaît la déchéance. Elle ne joue, elle se repose en grande partie sur Axler. Lorsque celui-ci chute à son tour, elle ne peut le supporter et s'envole pour la Californie rejoindre son fils. Axler se retrouve seul, et de nouveau il est hanté par le suicide. Mais il réagit en appelant son médecin qui l'envoie séjourner dans un hôpital psychiatrique.
Dans cet hôpital il a des entretiens avec un psychologue, il rencontre des autres patients qui ont tenté de se suicider et qui racontent leur expérience. Lui-même cherche des explications. Il n'en trouve pas. Et quand il commence a aller mieux, il ne comprend pas les raisons de cette amélioration : " c'était sans la moindre bonne raison qu'il avait perdu sa magie en tant qu'acteur, et c'est de façon tout aussi arbitraire que soin désir de mettre fin à ses jours s'était éloigné, du moins pour l'instant." (p. 24)
A l'hôpital il fait la connaissance de Sybil qui a tenté de se suicider lorsqu'elle a appris que son mari avait agressé sexuellement sa petite fille et qu'elle même n'avait rien fait pour le dénoncer. " Je n'ai rien fait de ce que j'aurais dû faire" dit-elle à Simon Axler.
Apparait ensuite Jerry Oppenheim, l'agent d'Axler. Jerry qui a plus de 80 ans essaie de convaincre Simon de remonter sur scène, il lui propose de jouer le rôle de James Tyrone au Guthrie. Simon refuse, au motif qu'il lui est impossible de jouer. Jerry insiste, lui propose même de rencontrer un médecin réputé, mais Simon ne veut rien savoir. "Jerry c'est terminé. Je n'arrive plus à rendre une pièce réelle pour les spectateurs. Je n'arrive plus à rendre un rôle réel pour moi."
A la fin de cette première partie Simon reçoit une lettre de Sybil l'ex-pensionnaire d' l'hôpital. Il se rappelle que cette femme lui avait demander de tuer le monstre qu'était son mari. Elle-même n'avait pu se suicider, Simon non plus. Si l'on est incapable de tuer des monstres comment arriver à se tuer soi-même.
Roth clôt cette première partie en rappelant au lecteur le choix qui se pose à Simon, : être ou ne pas être, continuer à vivre comme une larve ou se faire disparaître ?
2ème temps - La transformation
Axler, installé à la campagne, se voit comme un homme fini " il en avait bel et bien fini avec le métier d'acteur, les femmes, les rapports humains, fini à jamais avec le bonheur." (p. 46)
Roth reprend le thème qui hante son personnage : "Une fois de plus, le suicide était son point de mire, dépossédé de tout, il ne voyait pas d'autre issue." (p. 47)
Débarque alors dans sa vie Pegeen, la fille de deux de ses anciens amis acteurs. Elle a maintenant quarante ans. Roth nous raconte l'histoire de cette fille qui est lesbienne. Sa première partenaire Priscilla, avec qui elle vécut en couple pendant plusieurs années, décide un jour de se transformer en homme, elle ne supporte plus son corps. Pegeen la quitte immédiatement.
Elle rencontre une autre femme, directrice du département dans lequel elle travaille et établit avec elle une relation sexuelle. Puis, un jour Pegeen décide d'avoir une relation avec un homme et elle se rend chez l'ami de la famille Simon Axler, qui a aujourd'hui soixante cinq ans. La présence de Pegeen génère un déclic chez Simon : "Très vite il perdit le sentiment qu'il était seul sur terre, dépouillé de son talent. Il était heureux : sentiment inattendu." (p. 53) Ils font l'amour. La partenaire féminine de Pegeen se sent humilié et développe un comportement de haine et de folie furieuse. Elle cherche a faire revenir Pegeen par tous les moyens. Peu à peu Pegeen change d'allure et de comportement, elle se transforme en femme objet de désir d'un homme.
Simon reste néanmoins lucide, il doute en permanence et demande à Pegeen si la vie qu'ils vivent est bien ce qu'elle veut, si elle sait ce qu'elle fait. Celle-ci répond : "Oui, je le sais. J'aime ça... et je ne veux pas que ça s'arrête."
Axler, sait parfaitement qu'il court un risque, mais il décide de jouer le rôle jusqu'au bout : "Mais un jour viendra, pensa Axler, où les circonstances la placeront en position de force pour mettre un terme à la situation, alors que je me retrouverai en situation de faiblesse pour n'avoir pas eu la fermeté de rompre maintenant. Et quand elle sera forte et que je serai faible, le coup qui me sera porté sera insoutenable. Il était persuadé qu'il voyait clair dans leur avenir, et pourtant il ne pouvait rien faire pour changer les perspectives. Il était trop heureux pour opérer le moindre changement." (p. 61)
Axler sait où cette aventure va le conduire, mais il prend le risque, histoire de vivre quelques moments de bonheur en plus. Mieux vaut cela que le néant.
Viennent alors les pressions extérieures, celles exercées par Priscilla, celle exercées par les parents de Pegeen. Simon ne cherche pas à influencer Pegeen. Celle-ci continue à vouloir leur relation. Les pages où Roth relate les arguments des parents de Pegeen pour préserver leur fille de cette relation avec leur vieil ami, qui a été récemment interné dans un hôpital psychiatrique sont savoureuses.
3ème temps - Le dernier acte
Parallèlement, la relation évolue sur le plan sexuel, Pegeen et Simon font des expériences que Roth décrit avec maints détails : utilisation de sex-toys, triolisme etc. On sait que chez Roth l'homme se révèle à lui-même par son désir. Mais ici la recherche du plaisir sexuel est en quelque sorte un chant du cygne. Pegeen cultive de son côté à nouveau des relations homosexuelles. Ses parents exercent à nouveau une forte pression, Simon rencontre le père de Pegeen.
Entre temps, il apprend que Sybil a tué son mari d'un coup de fusil de chasse, ce qui pour lui signifie qu'elle a eu le courage de tuer. C'est pour lui un signe qu'il garde au fond de lui.
Soudain Axler se met à imaginer que Pegeen veut un enfant de lui. "Il voulait obliger sa propre témérité à rentrer dans un cadre domestique." Dans la foulée il imagine qu'il pourra reprendre sa vie d'acteur et jouer le rôle de James Power au Guthrie. Il se prend au jeu et tente des démarches dans un hôpital.
Attendant Pegeen pour lui révéler sa démarche, il accueille une femme distante et réticente... Il réfléchit et comprend qu'il n'a fait que s'enfoncer un peu plus dans un monde qu'il avait créé de toutes pièces.
Lorsque Pegeen lui annonce "C'est fini", tout s'effondre. "Je ne veux plus servir de palliatif à tes problèmes de carrière" lui lance-telle.
Axler panique, il cherche les causes possibles de cet abandon : Tracy, une fille de rencontre qui a séduit Pegeen, Asa et Carol, les parents de Pegeen... Tout ce qu'il a imaginé reconstruire se délite en un instant, alors réapparaît le thème du suicide et la référence à Sybil : "Oui, se dit-il, si elle est arrivée à trouver en elle les ressources pour faire quelque chose d'aussi terrible au mari qui était son démon, je devrais au moins être capable de m'infliger ça à moi-même." (p. 121)
Je ne dévoilerai pas la fin de l'histoire : Axler jouera t-il un rôle ou sera-t-il lui même un homme submergé par la peur et l'épouvante ?
J'ai bien aimé ce roman qui a pour thème à la fois la vieillesse et la mort. Quand le désir ne fut qu'une dernière illusion, faut-il jouer son dernier rôle pour transformer sa vie ?

 LIVREAPART
LIVREAPART