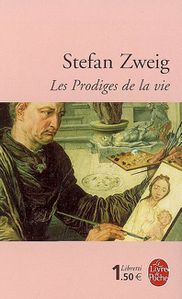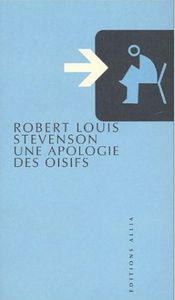Le livre ci-dessus présente deux nouvelles extraites de Goodbye Colombus dont l'une s'intitule : "Défenseur de la foi", celle dont nous parlons ci-après, et l'autre : "L'habit ne fait pas le moine".
Le personnage principal de "Défenseur de la foi" est le sergent Marx. Un sergent juif, dont le nom n'est pas choisi au hasard.
Dans un paragraphe introductif, Roth explique ce que le personnage en question a vécu et quels sont ses sentiments au retour de la guerre en 1945. Cette première description nous montre d'un coup d'oeil le grand talent de Roth. "... il y avait une inertie en moi qui me disait que nous volions vers un nouveau front où nous débarquerions et continuerions notre poussée vers l'est - toujours vers l'est, jusqu'à ce que nous ayons fait le tour du globe, défilant à travers les villages dont les rues pavées et tortueuses seraient remplies d'ennemis nous regardant prendre possession de ce qu'ils avaient considéré comme leur jusqu'à présent. J'avais suffisamment changé en deux ans pour ne plus être sensible au tremblement des vieillards, aux pleurs des tout-petits, à la crainte incertaine dans les yeux autrefois arrogants. En deux ans, j'avais eu la chance de me forger un coeur de soldat d'infanterie, lequel, comme ses pieds, commence par enfler et faire souffrir, puis finit par devenir suffisamment calleux pour lui permettre de parcourir les chemins les plus inquiétants sans rien sentir."
Pour l'armée, cet homme a une image, celle d'un héros : " C'est un vétéran du front européen et par conséquent il ne se laissera pas emmerder." Opinion glaciale comme un ordre militaire formulée par le capitaine Barrett. Marx est l'archétype du soldat qui a tout sacrifié à sa patrie et à la défense des principes de la liberté. La nouvelle va nous montrer à la fois le questionnement de ce personnage, ses hésitations, ses incertitudes, dans un monde qu'il a connu avant la guerre et dans lequel il est de retour, même s'il reste confiné dans une enceinte militaire avec de jeunes recrues. Ce sont ces hésitations entre communautarisme et application de la règle générale, entre le coeur et la raison qui font la substance du livre, le tout plongé dans un environnement bien spécifique qui est celui de la relation entre les juifs et les non-juifs aux Etats Unis.
Ce thème ne cessera de hanter Roth : question majeure qui circule dans l'ensemble de son oeuvre: « Que me sont les autres Juifs, que suis-je pour eux, et en vertu de quoi attendraient-ils de moi un traitement de faveur ?"? ».
L'intrigue
Un soldat, Sheldon Grossbart, cherche à approcher et à discuter avec le sergent Marx pour lui exposer le problème que pose pour les jeunes soldats juifs les "GI parties" (nettoyages de caserne) organisées le vendredi soir. Selon Grossbart, les autres soldats n'admettent pas que lui et ses camarades juifs puissent échapper à ces corvées en invoquant des obligations religieuses. C'est cette suspicion qu'affirme ne pas supporter Grossbart.
Roth décrit à merveille la manière dont le soldat Grossbart prend dans ses filets le sergent Marx. A la page 15 par exemple : "Il fit un geste de la main. Ce fut à peine perceptible, rien qu'une légère rotation du poignet, et cependant suffisant pour exclure de notre propos tout le reste de la salle de rapport, pour faire de nous deux le centre du monde." Puis Grossbart expose son problème : " Vous savez, sergent, m'expliqua t-il, le vendredi soir, les Juifs sont censés assister à l'office religieux." Marx répond qu'il s'agit d'un problème de religion à traiter comme tel et il renvoie Grossbart vers l'aumônier, et l'Inspecteur Général.
" - Non, non. Je ne veux pas faire d'histoire, sergent. C'est la première chose qu'ils vous jettent à la figure. Je veux juste mes droits !" rétorque Grossbart.
D'un côté le "ils" de "ils me jettent à la figure", donc l'agressivité des autres et de l'autre, le droit légitime d'exercer sa religion invoqué par Grossbart.
Le sergent Marx relate cette histoire d'office religieux et de soupçon des autres soldats au capitaine. Lorsqu'il l'expose, le capitaine a lui-même une réaction teintée de préjugés à l'égard du sergent, il est convaincu "que je ne cherchais pas tant à expliquer la position de Grossbart qu'à la défendre." Autrement dit le communautarisme juif émane des juifs eux-mêmes, mais il est aussi dans la tête de ceux qui ne sont pas juifs. Ainsi le capitaine incarne le regard de la société américaine sur les juifs et notamment les préjugés qu'elle véhicule. Un juif ne peut que défendre les intérêts de ses coreligionnaires et revendiquer sa différence, fut-il un militaire admiré et présenté comme un modèle.
Ce qui est intéressant dans la nouvelle, c'est de voir comment, à l'occasion des problèmes que lui pose Grossbart, le sergent se trouve coincé entre son rôle de sous-officier reconnu et admiré dans l'armée des Etats-Unis et son appartenance à la communauté juive.
Cette attitude incertaine et ambigüe révèle le "vacillement" des personnages de Roth. "Dois-je agir en soldat sans préjugés, defenseur de l'intérêt général et de la règle, ou dois-être solidaire d'autres juifs comme moi et consolider mon appartenance à cette communauté par un comportement de protection, voire de favoritisme ?"
Le discours du capitaine Barrett, quant à lui, est clair et net, il dit non aux particularismes, mais il n'est pas juif, c'est donc plus facile pour lui. Il applique des principes généraux, même si son discours traduit des préjugés : " Je me battrais aux côtés d'un nègre si le gars me prouvait qu'il est un homme... Personne ne reçoit de traitement spécial ici, en bien ou en mal. Tout ce que j'attends d'un homme, c'est qu'il fasse ses preuves."
Le sergent Marx, après avoir discuté avec le capitaine informe un subordonné de rappeler aux hommes cette règle : " Les hommes sont libres d'assister aux offices religieux, quelle que soit l'heure à laquelle ils ont lieu..." Le subordonné transmetl les instructions données en ces termes : "Le chef m'a dit de vous dire que tous les juifs qui veulent devront se rassembler ici à 19h heures pour assister à la messe juive."
Pour Grossbart, ce rappel répond à son attente, parce qu'il officialise la reconnaissance du droit des juifs à se rendre à la synagogue le vendredi soir plutôt qu'à procéder à un nettoyage de caserne. Il adresse ses remerciements au sergent, appuyé par deux de ses camarades juifs. Grossbart invite alors le sergent à participer lui-même à l'office religieux à 19h. Cette invitation touche Marx au plus profond de lui-même. Il repense à son enfance dans le Bronx. Ses sentiments refont surface. " J'eus l'impression qu'une main avait ouvert mon être et l'avait pénétré jusqu'au fond..." Roth nous fait plonger au coeur du débat intérieur que vit le sergent avec une grande habileté. Et le résultat ne se fait pas attendre : "Ce ne fut donc pas tout à fait étrange qu'à la recherche de moi-même, je me retrouvai en train de suivre les pas de Grossbart vers la chapelle numéro 3 où avaient lieu les offices religieux israélites..."
L'ambiguïté est au coin de chaque page dans cette nouvelle et c'est pour moi ce qui en fait tout l'intérêt.
Viennent ensuite l'histoire de la nourriture proposée à la cantine du camp d'instruction et celle de la Pâque juive.
Grossbart et deux de ses coreligionnaires ne comprennent pas pourquoi on les oblige à manger de la nourriture non kasher, qui " a un goût de cendres" pour eux et pourquoi ils ne leur est pas possible de partir en permission pendant la période d'instruction, alors qu'ils sont consignés, pour fêter la pâque juive... un mois après la date officielle il est vrai, dans la famille de Grossbart à Saint Louis.
Grossbart demande une une permission pour lui-même à Marx pour fêter la pâque en famille. Le sergent Marx oppose cette fois-ci un refus catégorique à cette nouvelle demande. Il est excédé :
" - Grossbart, pourquoi ne pouvez-vous pas être comme les autres ? Pourquoi faut-il que vous soyez planté comme une épine dans le pied ? Pourquoi demandez-vous un traitement spécial ?
- Parce que je suis juif, sergent. Je suis différent. Meilleur ou non. Mais différent."
Grossbart fait le forcing et décide de partir coûte que coûte, sans permission, pour assister au repas du Seider dans sa famille. Grossbart, tourmenté, tiraillé entre deux attitudes, le rappelle et signe sa permission dans un élan de solidarité. Mais il demande à Grossbart de n'en parler à personne. Ce dernier remercie le sergent : " Vous êtes un bon juif, sergent. Vous aimez penser que vous avez le coeur dur, mais au fond vous êtes un brave type. Je le pense vraiment."
Quelques minutes plus tard, Grossbart revient avec Fishbein et Halpern, deux autres jeunes recrues, juifs également, et il demande à Marx de signer une permission pour chacun de ses deux acolytes. Grossbart et les deux autres font un peu de chantage et le sergent Marx cède. Il demande en contrepartie que les trois soldats lui rapportent un morceau de gâteau de la fête religieuse.
Entre temps, Marx apprend que toutes les nouvelles recrues seront envoyées dans le Pacifique après leur période d'instruction. Grossbart, qui aimerait savoir où les soldats de sa compagnie vont être affectés, vient voir le sergent dans sa chambre en prêchant le faux pour connaître le vrai. Marx conscient de la stratégie de Grossbart, lui apprend la future affectation des hommes de la compagnie. Il en profite pour réclamer le morceau de gâteau de pâque promis en contrepartie de la permission accordée. Grossbart lui remet alors un paquet qui s'avère être un pâté aux oeufs qu'on trouve dans les restaurants chinois. Le sergent découvre alors le bobard que les trois soldats lui ont raconté et il éclate : " - Grossbart vous êtes un menteur ! Vous êtes un hypocrite et un escroc. Vous n'avez aucun respect pour quoi que ce soit."
Marx prend conscience qu'il s'est fait manipuler et que la pratique religieuse n'atit qu'un prétexte. Il décide d'organiser la riposte. Il prend connaissance de la liste d'affectation des soldats. Seul un d'entre eux échappe à l'affectation dans le Pacifique : Grossbart. Ce dernier est affecté dans le New Jersey, grâce à du piston.
Le sergent tient sa revanche. Il fait substituer au nom de Grossbart un autre nom en racontant un gros mensonge, comme Grossbart l'avait fait avec lui. Sheldon Grossbart apprend ce qui s'est passé par le sous-officier qui l'avait pistonné, juif également, et il interpelle le sergent en lui demandant des explications. Marx de lui répondre : " - Nous devons apprendre à nous occuper les uns des autres, Sheldon. C'est vous qui l'avez dit.
- Vous appelez ça vous occuper de moi, ce que vous avez fait ?
- Non, de nous tous." Iui répond le sergent.
Telle est la conclusion de cette histoire.
Analyse sommaire
Il parait que Roth, à cause de cette nouvelle, fut accusé d'attiser l'antisémitisme aux Etats-Unis. En réalité la nouvelle pose la question du communautarisme religieux et des relations entre citoyens au sein d'une démocratie.
Lorsqu'on dispose d'un minimum de pouvoir, peut-on favoriser ceux qui ont les mêmes origines ou les mêmes croyances que soi par rapport à l'ensemble des citoyens ? Cette question très actuelle n'est pas simple à résoudre, car celui qui a un embryon de pouvoir peut être écartelé entre l'application de la règle générale et la défense des intérêts collectifs des personnes de son groupe. Cest le cas du sergent Marx.
Dans la nouvelle, la situation nous montre que des arguments communautaires religieux peuvent masquer d'autres intérêts, totalement individuels. C'est ce qu'incarne le personnage de Grossbart.
La question est posée ici sous l'angle particulier des Juifs pratiquants, en prenant en compte d'une part les obligations religieuses qui s'imposent à eux, et d'autre part les préjugés véhiculés par la société qui faussent la plupart des situations.
Le sergent Marx, incarne l'incertitude des choix de celui qui a un petit pouvoir et qui décide d'aider des soldats juifs comme lui dans la défense de leurs revendications religieuses. Le hic c'est que se cachent derrière ces revendications religieuses des besoins individuels qui n'ont rien à voir avec la religion, du moins pour Grossbart. Marx s'en rend compte et il remet en cause ses propres choix à la lumière des comportements des trois soldats juifs. Il découvre par lui-même que le favoritisme et le piston entre ceux qui appartiennent à la communauté juive ne font qu'engendrer l'injustice et renforcer l'antisémitisme.
On comprend que rien n'est simple dans ce combat entre le coeur et la raison, entre la règle générale et les intérêts particuliers. Comment concilier la règle générale, le respect des croyances et en même temps rester vigilant sur ce qui peut expliquer certains comportements humains. Roth nous invite à nous poser des questions et à prendre du recul sur les relations entre les hommes dans un monde où le communautarisme tend à se développer.
Qui ne s'est pas posé ce genre de question, à un moment de sa vie ?

 LIVREAPART
LIVREAPART